- Quel est votre parcours ?
- Je suis née à Paris, il y a 37 ans. J’ai grandi en banlieue. J’ai fait du droit, passé ma licence, mais je ne me voyais ni avocate, ni juge, ni juriste. J’ai fait, ensuite, un DEA d’histoire de l’art, mais je ne me voyais ni commissaire d’exposition, ni commissaire priseur, ni conservatrice de musée. Alors, j’ai commencé à écrire des articles sur l’art contemporain parce que l’art d’aujourd’hui nous parle de nouveaux espaces, de territoires insondés. Il fabrique des idées, des chocs, de la beauté, du bizarre, des troubles et des transgressions. Il laisse aussi des vides, des blancs. Il imprime des émotions ou une mémoire, il éclaire le monde et il peut, parfois, nous transformer. Je travaille également à mi-temps dans un magazine culturel, un boulot alimentaire, le métier de pigiste spécialisé étant précaire.
- Quel est votre rapport avec la Corse ?
- Ma grand-mère était Corse. Elle est née à Ocana, un petit village près d’Ajaccio et du lac de Tolla. C’était une femme fière. Petite, menue, elle a gardé le même poids toute sa vie : 45 kilos de fierté ! Elle m’a appris à tenir la tête et le menton hauts, à rester debout, quoi qu’il arrive. Aujourd’hui, au village, mes cousins, ma famille sont toujours là, très attachés à la terre de leurs parents et de leurs grands-parents. Petite, puis adolescente, j’ai passé les meilleurs étés de ma vie à Barbicaja, dans une maison aujourd’hui vendue, entourée par le violet pétant des bougainvilliers et toujours pleine à craquer d’amis. Une maison qui se trouvait sur la route des Sanguinaires quand il n’y avait alors qu’un chemin de terre, et pour horizon que la mer en bas, et le maquis là-haut. C’était un paradis et un parfum. Le parfum de la Corse ! Son odeur si particulière, je la reconnaîtrais toujours. Dès que je pose encore aujourd’hui un pied sur le tarmac de Campo dell’Oro, elle me précipite dans l’enfance. C’était aussi le soleil bien sûr, les potes, la plage jusque dans la nuit, jusqu’au petit matin, le volley sur cette plage, les glaces, les bières à la terrasse du café Pech, les soirées à la Cinquième avenue, les truites pêchées à quatre heure du mat’ à la fouine dans la rivière et cuites avec le thym sauvage dans le feu de la cheminée du refuge... C’était, avec mon frère, les queues des lézards que l’on capturait avec un lasso de fortune fait d’une herbe fragile, les rouleaux et les déferlantes de Capo di Feno, les gens, les amitiés nouées, les fous-rires, et la vie, l’avenir qu’on imaginait. Et puis, c’était des larmes quand il fallait partir et que l’on regardait, sur le ferry, l’île s’éloigner.
- Je suis née à Paris, il y a 37 ans. J’ai grandi en banlieue. J’ai fait du droit, passé ma licence, mais je ne me voyais ni avocate, ni juge, ni juriste. J’ai fait, ensuite, un DEA d’histoire de l’art, mais je ne me voyais ni commissaire d’exposition, ni commissaire priseur, ni conservatrice de musée. Alors, j’ai commencé à écrire des articles sur l’art contemporain parce que l’art d’aujourd’hui nous parle de nouveaux espaces, de territoires insondés. Il fabrique des idées, des chocs, de la beauté, du bizarre, des troubles et des transgressions. Il laisse aussi des vides, des blancs. Il imprime des émotions ou une mémoire, il éclaire le monde et il peut, parfois, nous transformer. Je travaille également à mi-temps dans un magazine culturel, un boulot alimentaire, le métier de pigiste spécialisé étant précaire.
- Quel est votre rapport avec la Corse ?
- Ma grand-mère était Corse. Elle est née à Ocana, un petit village près d’Ajaccio et du lac de Tolla. C’était une femme fière. Petite, menue, elle a gardé le même poids toute sa vie : 45 kilos de fierté ! Elle m’a appris à tenir la tête et le menton hauts, à rester debout, quoi qu’il arrive. Aujourd’hui, au village, mes cousins, ma famille sont toujours là, très attachés à la terre de leurs parents et de leurs grands-parents. Petite, puis adolescente, j’ai passé les meilleurs étés de ma vie à Barbicaja, dans une maison aujourd’hui vendue, entourée par le violet pétant des bougainvilliers et toujours pleine à craquer d’amis. Une maison qui se trouvait sur la route des Sanguinaires quand il n’y avait alors qu’un chemin de terre, et pour horizon que la mer en bas, et le maquis là-haut. C’était un paradis et un parfum. Le parfum de la Corse ! Son odeur si particulière, je la reconnaîtrais toujours. Dès que je pose encore aujourd’hui un pied sur le tarmac de Campo dell’Oro, elle me précipite dans l’enfance. C’était aussi le soleil bien sûr, les potes, la plage jusque dans la nuit, jusqu’au petit matin, le volley sur cette plage, les glaces, les bières à la terrasse du café Pech, les soirées à la Cinquième avenue, les truites pêchées à quatre heure du mat’ à la fouine dans la rivière et cuites avec le thym sauvage dans le feu de la cheminée du refuge... C’était, avec mon frère, les queues des lézards que l’on capturait avec un lasso de fortune fait d’une herbe fragile, les rouleaux et les déferlantes de Capo di Feno, les gens, les amitiés nouées, les fous-rires, et la vie, l’avenir qu’on imaginait. Et puis, c’était des larmes quand il fallait partir et que l’on regardait, sur le ferry, l’île s’éloigner.
- Comment est né votre goût pour l’écriture ?
- Un livre est un espace de liberté totale, comme une peinture. J'écris pour ne plus avoir peur. Il y a, pour moi, dans le fait d’écrire, quelque chose qui précède la pensée, qui est en amont de la réflexion, qui se situe dans les sous-sols de l’intime. C’est souterrain, c’est un langage dormant à extirper de sa nuit. C’est comme descendre à la cave, ouvrir une porte et regarder ce que l’on a accumulé comme poussière, vieilleries, effrois, innocence et enfance perdues. C’est convertir l’intérieur en extérieur, être le passeur d’un lieu sombre où s’amassent les obsessions. Et ce que j’ai trouvé « dans ma cave », c’est la perte, la destruction, le sexe, la mort, la solitude, la ville, l’amour. Et tout ça, je l’ai projeté dans mon personnage principal, Lola. C’est un premier livre, et comme toutes les premières fois, on y met ses tripes. J’ai envoyé mon manuscrit par la poste et j’ai eu cette incroyable chance d’être publiée aux éditions Stock.

- Parlez-nous de votre livre
- Moro-sphinx raconte l’histoire de Lola, une Parisienne paumée, sauvage, errante, en pleine déréliction, qui n’a plus que son corps pour se perdre. Elle est perchée sur des talons gratte-ciel, porte des jupes très courtes, se maquille comme un camion. La nuit, elle sort dans Paris. Comme un animal sensuel, elle arpente la ville en tous sens à la recherche d’hommes. Elle chasse ses proies dans les bars, les fêtes foraines, chez Darty, dans les cinémas. Elle traque les plus laids, les plus ploucs, les plus repoussants pour se sentir intouchable. Et après l’acte, clac, elle leur coupe un ongle…
- Pourquoi ?
- Lola est une amazone contemporaine, une femme fatale, vengeresse. Elle a ce côté métallique, presque mécanique, tranchant comme la lame d’un couteau. Mais sous le maquillage, sous le costume, derrière la prédatrice, apparaît une femme blessée, qui a fait une sortie de route, une femme cadenassée par ses angoisses et les deuils impossibles de ses amours mortes. Le personnage est constamment confronté à des oppositions, à des duels intimes entre son corps et son crâne, entre le vide et le plein, l’oubli et la résistance à l’oubli, le beau et le laid, la folie et la raison, le pénétré et le pénétrant, la soumission et l’indocilité, la pulsion de vie et la pulsion de mort.
Lola pose cette question, quand il n’y a plus d’amour, quand on a plus rien, que fait-on ? Qui devient-on ? Quels choix prend-on ? Comment l’homme des villes survit-il à sa solitude ? Quand on n’a pas de rêve, plus de rêve, plus de liens, ne va-t-on pas piocher dans les excès ? Aujourd’hui, un français sur huit est seul. On va suivre, tout on long du livre, l’héroïne dans sa cadence, dans ses frasques et ses traques jusqu’à ce qu’elle rencontre un homme, jusqu’à ce que l’amour frappe, de nouveau, à sa porte. Mais est-elle vraiment faite pour ça ?
- Comment qualifieriez-vous votre livre ?
- Moro-sphinx est un livre sombre, mais qui joue très souvent avec le ridicule, le fantasque, le grotesque et l’exagération qui collent aux personnages secondaires et viennent contrebalancer la noirceur de Lola. Cette alliance entre l’angoisse et le sourire est une issue de secours, elle permet une mise à distance.
- Pourquoi ce titre "Moro-sphinx" ?
- Les moro-sphinx sont des papillons crépusculaires. Ils sortent quand le soleil se couche. Ils ressemblent à de gros frelons turbulents, bruyants, toujours en mouvement. Leur trompe immense leur permet de butiner le nectar au fond des fleurs les plus profondes. Ils ressemblent beaucoup à mon héroïne. Et puis, bien sûr, dans moro-sphinx, on entend mort au sphinx. Mort à cette figure mythologique, énigmatique, charnelle, vengeresse et suicidaire.
- Avez vous des projets littéraires à venir ?
- Oui, je travaille actuellement sur un ouvrage dont l’histoire se déroulera dans un village de Corse mais je n’en dis pas plus pour le moment.
- Moro-sphinx raconte l’histoire de Lola, une Parisienne paumée, sauvage, errante, en pleine déréliction, qui n’a plus que son corps pour se perdre. Elle est perchée sur des talons gratte-ciel, porte des jupes très courtes, se maquille comme un camion. La nuit, elle sort dans Paris. Comme un animal sensuel, elle arpente la ville en tous sens à la recherche d’hommes. Elle chasse ses proies dans les bars, les fêtes foraines, chez Darty, dans les cinémas. Elle traque les plus laids, les plus ploucs, les plus repoussants pour se sentir intouchable. Et après l’acte, clac, elle leur coupe un ongle…
- Pourquoi ?
- Lola est une amazone contemporaine, une femme fatale, vengeresse. Elle a ce côté métallique, presque mécanique, tranchant comme la lame d’un couteau. Mais sous le maquillage, sous le costume, derrière la prédatrice, apparaît une femme blessée, qui a fait une sortie de route, une femme cadenassée par ses angoisses et les deuils impossibles de ses amours mortes. Le personnage est constamment confronté à des oppositions, à des duels intimes entre son corps et son crâne, entre le vide et le plein, l’oubli et la résistance à l’oubli, le beau et le laid, la folie et la raison, le pénétré et le pénétrant, la soumission et l’indocilité, la pulsion de vie et la pulsion de mort.
Lola pose cette question, quand il n’y a plus d’amour, quand on a plus rien, que fait-on ? Qui devient-on ? Quels choix prend-on ? Comment l’homme des villes survit-il à sa solitude ? Quand on n’a pas de rêve, plus de rêve, plus de liens, ne va-t-on pas piocher dans les excès ? Aujourd’hui, un français sur huit est seul. On va suivre, tout on long du livre, l’héroïne dans sa cadence, dans ses frasques et ses traques jusqu’à ce qu’elle rencontre un homme, jusqu’à ce que l’amour frappe, de nouveau, à sa porte. Mais est-elle vraiment faite pour ça ?
- Comment qualifieriez-vous votre livre ?
- Moro-sphinx est un livre sombre, mais qui joue très souvent avec le ridicule, le fantasque, le grotesque et l’exagération qui collent aux personnages secondaires et viennent contrebalancer la noirceur de Lola. Cette alliance entre l’angoisse et le sourire est une issue de secours, elle permet une mise à distance.
- Pourquoi ce titre "Moro-sphinx" ?
- Les moro-sphinx sont des papillons crépusculaires. Ils sortent quand le soleil se couche. Ils ressemblent à de gros frelons turbulents, bruyants, toujours en mouvement. Leur trompe immense leur permet de butiner le nectar au fond des fleurs les plus profondes. Ils ressemblent beaucoup à mon héroïne. Et puis, bien sûr, dans moro-sphinx, on entend mort au sphinx. Mort à cette figure mythologique, énigmatique, charnelle, vengeresse et suicidaire.
- Avez vous des projets littéraires à venir ?
- Oui, je travaille actuellement sur un ouvrage dont l’histoire se déroulera dans un village de Corse mais je n’en dis pas plus pour le moment.











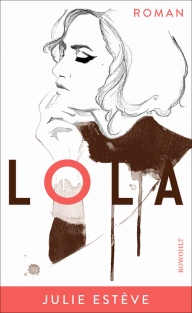




 Envoyer à un ami
Envoyer à un ami Version imprimable
Version imprimable





