- C’est en tant qu’économiste que vous venez de remporter le prix international du développement local et territorial dans la section chercheur – un prix qui n’est attribué, faut-il le rappeler, que tous les six ou sept ans, puisque le précédent remonte même à 2017. Qu’est-ce qui vous a déterminé à vous consacrer à l’économie ?
- C’est tout simple. Après mon baccalauréat, je suis parti à l’université de Nice – il n’y avait pas encore d’université en Corse... Et j’ai choisi l’économie, parce que mon frère aîné était lui- même économiste.
- Vous êtes-vous tout de suite intéressé au monde rural ?
- Pas du tout ! J’ai même fait un doctorat d’économie industrielle, avec pour sujet : « L’impact des nationalisations sur l’économie française ». J’avais commencé mon doctorat en 1982. C’était juste au moment des nationalisations d’entreprises de Mitterrand : un programme massif ! Il y avait beaucoup de discussions, entre économistes, sur l’intérêt de ces mesures : allaient-elles relancer la croissance de l’économie française ? Dans mon travail, j’ai démontré que ce n’était pas le cas. Et j’ai reçu le prix de la meilleure thèse en économie industrielle au niveau national. On était bien loin du développement rural !
- Le développement rural restait donc encore loin de vos préoccupations...
-En fait, j’ai été reçu major au concours du CNRS, ce qui m’a donné l’opportunité de choisir mon centre : j’ai opté pour Sophia-Antipolis. J’étais donc chercheur sur la technopole, mais en économie industrielle et de l’innovation. Pas du tout sur les questions régionales.
Pourtant, cette question du développement territorial me taraudait en tant que Corse. Comment se faisait-il que la Corse ne se développe pas... ou du moins pas beaucoup ? J’ai commencé à me pencher sur les questions du territoire. Pour deux raisons. D’abord pour cette raison purement “citoyenne”. Mais également parce que je travaillais dans une technopole. Je m’explique : elle avait été conçue comme un lieu fermé dans lequel les chercheurs allaient se retrouver, discuter, germiner... avec l’idée que ça allait percoler. Comme dans la Silicon Valley. On appelait ça “l’effet cafétéria”. Cette dimension purement locale de l’innovation, c’était donc très important. Et ça a plutôt bien fonctionné : on a transformé un lieu initialement touristique en un endroit high-tech.
- Quelle est l’étape suivante qui vous a permis de progresser significativement dans ces travaux de recherche ?
- C’est en 1999, lorsque j’ai eu la chance qu’on me propose un poste de directeur de recherche à l’INRA-AgroParisTech, la plus grosse école d’ingénieurs en agriculture, alimentation et environnement, en France. Je venais de passer quatre ans à l’INRA de Corte et j’étais donc un peu connu à l’institut. C’est là que j’ai créé une équipe de recherche baptisée “Proximité”... et qui existe toujours. Nous étions environs vingt-cinq personnes toutes disciplines confondues : économistes, sociologues, écologues, psychologues, agronomes. Nous nous sommes consacrés à la problématique territoriale : “proximité”, comme son nom l’indique. Ça a été le fil rouge de ma carrière !
- Cette notion de proximité, comment a-t-elle été reçue dans le monde scientifique ?
- Initialement, quand j’avais commencé à travailler dessus, en 1991, ce n’était pas du tout un sujet de recherche ! Mais le terme était devenu courant dans le public. Nous étions six chercheurs fondateurs, à l’époque : trois économistes industriels et trois économistes régionaux. Nous nous sommes réunis à l’Université Dauphine, et nous nous sommes dit : on va travailler dessus. Comment pouvait-on analyser la proximité ? Alors, nous avons publié un manifeste, dans une revue scientifique : « Et pourtant, ça marche ! ». Parce qu’il existait plein d’histoires de proximité : on ne savait pas pourquoi, mais ça marchait ! Shenzhen en Chine, la Silicon Valley en Californie, Sophia-Antipolis en France ! Or les effets de la proximité n’étaient jamais analysés dans la littérature économique !
Notre manifeste a eu un petit retentissement dans notre milieu. On a commencé à faire des colloques, des journées de la proximité, des articles et des livres collectifs... A ce moment-là, c’était plus l’innovation que le rural, qui m’intéressait. Peu à peu, les gens sont venus nous voir : nous étions une centaine, puis davantage... Le champ a même débordé jusqu’à intégrer la géographie... Aujourd’hui encore, à travers le monde, on appelle ça « l’École française de la proximité ». Elle a été très importante au début des années 2000. Puis d’autres ont été créées, comme l’École hollandaise...
- C’est cette notion qui vous a fait connaître ?
- Oui, tout à fait. Au point qu’en 2022, j’ai publié le « Handbook of Proximity Relations » chez le plus grand éditeur du monde économique : un bilan de toute cette recherche. C’est pour ces travaux que je suis connu à l’étranger, avec le 2ème article le plus cité sur le sujet. Par exemple le géographe Ron Boschma et moi-même sommes invités pendant une semaine à l’université de Toulouse, en novembre, sur ce thème.
- Ces travaux ont-ils des applications pratiques, dans le quotidien des gens ?
- J’y viens. En 2008, j’ai été nommé directeur des programmes PSDR : “Pour et Sur le Développement Régional”. Ces programmes étaient constitués de projets participatifs, portés à la fois par un chercheur et quelqu’un qui venait de la société – exploitant agricole, entrepreneur, directeur de Parc, ou autre... : l’élevage de chèvres dans le Berry, le développement de pratiques agroécologiques d’élevage bovin dans les Pays de la Loire, le panier de biens dans la région grenobloise – ancêtre du circuit court, ou l’huile d’olive de Nyons... Des projets ancrés localement, avec des gens travaillant dans des associations locales, et toujours le souci de la rentabilité parce qu’il faut pouvoir en vivre... On est parti petit, mais ça a grossi parce que c’était une attente sociétale. Les projets étaient financés moitié-moitié entre l’INRAE et la Région – une quinzaine de millions d’euros au total. J’ai acquis une connaissance extrêmement
- C’est tout simple. Après mon baccalauréat, je suis parti à l’université de Nice – il n’y avait pas encore d’université en Corse... Et j’ai choisi l’économie, parce que mon frère aîné était lui- même économiste.
- Vous êtes-vous tout de suite intéressé au monde rural ?
- Pas du tout ! J’ai même fait un doctorat d’économie industrielle, avec pour sujet : « L’impact des nationalisations sur l’économie française ». J’avais commencé mon doctorat en 1982. C’était juste au moment des nationalisations d’entreprises de Mitterrand : un programme massif ! Il y avait beaucoup de discussions, entre économistes, sur l’intérêt de ces mesures : allaient-elles relancer la croissance de l’économie française ? Dans mon travail, j’ai démontré que ce n’était pas le cas. Et j’ai reçu le prix de la meilleure thèse en économie industrielle au niveau national. On était bien loin du développement rural !
- Le développement rural restait donc encore loin de vos préoccupations...
-En fait, j’ai été reçu major au concours du CNRS, ce qui m’a donné l’opportunité de choisir mon centre : j’ai opté pour Sophia-Antipolis. J’étais donc chercheur sur la technopole, mais en économie industrielle et de l’innovation. Pas du tout sur les questions régionales.
Pourtant, cette question du développement territorial me taraudait en tant que Corse. Comment se faisait-il que la Corse ne se développe pas... ou du moins pas beaucoup ? J’ai commencé à me pencher sur les questions du territoire. Pour deux raisons. D’abord pour cette raison purement “citoyenne”. Mais également parce que je travaillais dans une technopole. Je m’explique : elle avait été conçue comme un lieu fermé dans lequel les chercheurs allaient se retrouver, discuter, germiner... avec l’idée que ça allait percoler. Comme dans la Silicon Valley. On appelait ça “l’effet cafétéria”. Cette dimension purement locale de l’innovation, c’était donc très important. Et ça a plutôt bien fonctionné : on a transformé un lieu initialement touristique en un endroit high-tech.
- Quelle est l’étape suivante qui vous a permis de progresser significativement dans ces travaux de recherche ?
- C’est en 1999, lorsque j’ai eu la chance qu’on me propose un poste de directeur de recherche à l’INRA-AgroParisTech, la plus grosse école d’ingénieurs en agriculture, alimentation et environnement, en France. Je venais de passer quatre ans à l’INRA de Corte et j’étais donc un peu connu à l’institut. C’est là que j’ai créé une équipe de recherche baptisée “Proximité”... et qui existe toujours. Nous étions environs vingt-cinq personnes toutes disciplines confondues : économistes, sociologues, écologues, psychologues, agronomes. Nous nous sommes consacrés à la problématique territoriale : “proximité”, comme son nom l’indique. Ça a été le fil rouge de ma carrière !
- Cette notion de proximité, comment a-t-elle été reçue dans le monde scientifique ?
- Initialement, quand j’avais commencé à travailler dessus, en 1991, ce n’était pas du tout un sujet de recherche ! Mais le terme était devenu courant dans le public. Nous étions six chercheurs fondateurs, à l’époque : trois économistes industriels et trois économistes régionaux. Nous nous sommes réunis à l’Université Dauphine, et nous nous sommes dit : on va travailler dessus. Comment pouvait-on analyser la proximité ? Alors, nous avons publié un manifeste, dans une revue scientifique : « Et pourtant, ça marche ! ». Parce qu’il existait plein d’histoires de proximité : on ne savait pas pourquoi, mais ça marchait ! Shenzhen en Chine, la Silicon Valley en Californie, Sophia-Antipolis en France ! Or les effets de la proximité n’étaient jamais analysés dans la littérature économique !
Notre manifeste a eu un petit retentissement dans notre milieu. On a commencé à faire des colloques, des journées de la proximité, des articles et des livres collectifs... A ce moment-là, c’était plus l’innovation que le rural, qui m’intéressait. Peu à peu, les gens sont venus nous voir : nous étions une centaine, puis davantage... Le champ a même débordé jusqu’à intégrer la géographie... Aujourd’hui encore, à travers le monde, on appelle ça « l’École française de la proximité ». Elle a été très importante au début des années 2000. Puis d’autres ont été créées, comme l’École hollandaise...
- C’est cette notion qui vous a fait connaître ?
- Oui, tout à fait. Au point qu’en 2022, j’ai publié le « Handbook of Proximity Relations » chez le plus grand éditeur du monde économique : un bilan de toute cette recherche. C’est pour ces travaux que je suis connu à l’étranger, avec le 2ème article le plus cité sur le sujet. Par exemple le géographe Ron Boschma et moi-même sommes invités pendant une semaine à l’université de Toulouse, en novembre, sur ce thème.
- Ces travaux ont-ils des applications pratiques, dans le quotidien des gens ?
- J’y viens. En 2008, j’ai été nommé directeur des programmes PSDR : “Pour et Sur le Développement Régional”. Ces programmes étaient constitués de projets participatifs, portés à la fois par un chercheur et quelqu’un qui venait de la société – exploitant agricole, entrepreneur, directeur de Parc, ou autre... : l’élevage de chèvres dans le Berry, le développement de pratiques agroécologiques d’élevage bovin dans les Pays de la Loire, le panier de biens dans la région grenobloise – ancêtre du circuit court, ou l’huile d’olive de Nyons... Des projets ancrés localement, avec des gens travaillant dans des associations locales, et toujours le souci de la rentabilité parce qu’il faut pouvoir en vivre... On est parti petit, mais ça a grossi parce que c’était une attente sociétale. Les projets étaient financés moitié-moitié entre l’INRAE et la Région – une quinzaine de millions d’euros au total. J’ai acquis une connaissance extrêmement
fine et de terrain du développement local et territorial. J’ai commencé à écrire avec des sociologues, des géographes, des aménageurs, psychologues, écologues, zootechniciens, agronomes, mathématiciens ! Et ça a déterminé ma seconde phase de recherche.
- Votre vision du développement rural a-t-elle évolué à la lumière de ces travaux ?
- J’ai beaucoup contribué à une vision de l’innovation qui ne soit pas celle du high-tech. Une innovation “au quotidien”. Ça peut concerner le transport en zone rurale, une SCOP, un circuit court... Par ailleurs, jusque-là, je ne me sentais pas légitime ni capable d’avoir une explication du développement territorial et local différente de celle prônée par ceux dont c’était la spécialité. Mais je restais insatisfait de ce qu’ils disaient. C’était une vision trop étriquée. Du coup, après 2010, avec mon expérience, j’ai pu me confronter à cette question. En 2015, j’ai publié un article qui a eu un grand retentissement, fruit de plusieurs années de réflexion, intitulé « Théorie du développement territorial ». Un développement qui ne se limite pas à la production de biens et de services, mais intègre par exemple, les usages des sols... Et je me suis intéressé aux conflits dont les scientifiques refusaient de parler. Or, pour se développer, il faut aussi s’opposer. Le conflit est fondateur. Il génère de l’innovation. C’est le point de départ de mes recherches en développement territorial. Et ce sont ces travaux qui sont récompensés par le prix...
- Depuis 2021, vous êtes Président du centre INRAE de Corse. Comment mettez-vous vos travaux de recherche au service de cette nouvelle fonction et de la Corse ?
- Lorsque j’ai été nommé en Corse, j’ai voulu y apporter ma compétence et ma connaissance du développement territorial. Je me suis dit : « Comment est-ce que je peux les aider ? ». De deux façons en fait : à la fois par mes réseaux de connaissances à l’INRAE et dans le monde de la recherche en général. Et également par cette compétence d’appui aux projets : tous les projets qui relèvent du développement territorial. Par exemple, dans le cadre du développement de la filière “châtaignes”, pour préserver la vie à l’intérieur des terres en faisant en sorte que ce soit viable, que les producteurs gagnent leur vie. Comment l’écosystème de la châtaigneraie peut continuer à exister et irriguer la vie et les paysages de certains villages, avec des activités professionnelles. Mais à l’opposé, également, par exemple, dans le cadre de la mandarine de printemps : une innovation technologique née dans nos labos, que l’on transfère, que l’on va mettre en production, au service des agrumiculteurs, de cette filière puissante qui apporte de la richesse en Corse et sert donc à son développement.
André Torre vient de recevoir une nouvelle reconnaissance de la communauté internationale de la recherche : il a été nommé top scientiste. Pour l’ensemble de sa carrière, et en rapport avec le nombre de citations de ses travaux dans des revues scientifiques, il est classé 29ème mondial dans le domaine du rural et 4ème dans celui de l’économie rurale.
- Votre vision du développement rural a-t-elle évolué à la lumière de ces travaux ?
- J’ai beaucoup contribué à une vision de l’innovation qui ne soit pas celle du high-tech. Une innovation “au quotidien”. Ça peut concerner le transport en zone rurale, une SCOP, un circuit court... Par ailleurs, jusque-là, je ne me sentais pas légitime ni capable d’avoir une explication du développement territorial et local différente de celle prônée par ceux dont c’était la spécialité. Mais je restais insatisfait de ce qu’ils disaient. C’était une vision trop étriquée. Du coup, après 2010, avec mon expérience, j’ai pu me confronter à cette question. En 2015, j’ai publié un article qui a eu un grand retentissement, fruit de plusieurs années de réflexion, intitulé « Théorie du développement territorial ». Un développement qui ne se limite pas à la production de biens et de services, mais intègre par exemple, les usages des sols... Et je me suis intéressé aux conflits dont les scientifiques refusaient de parler. Or, pour se développer, il faut aussi s’opposer. Le conflit est fondateur. Il génère de l’innovation. C’est le point de départ de mes recherches en développement territorial. Et ce sont ces travaux qui sont récompensés par le prix...
- Depuis 2021, vous êtes Président du centre INRAE de Corse. Comment mettez-vous vos travaux de recherche au service de cette nouvelle fonction et de la Corse ?
- Lorsque j’ai été nommé en Corse, j’ai voulu y apporter ma compétence et ma connaissance du développement territorial. Je me suis dit : « Comment est-ce que je peux les aider ? ». De deux façons en fait : à la fois par mes réseaux de connaissances à l’INRAE et dans le monde de la recherche en général. Et également par cette compétence d’appui aux projets : tous les projets qui relèvent du développement territorial. Par exemple, dans le cadre du développement de la filière “châtaignes”, pour préserver la vie à l’intérieur des terres en faisant en sorte que ce soit viable, que les producteurs gagnent leur vie. Comment l’écosystème de la châtaigneraie peut continuer à exister et irriguer la vie et les paysages de certains villages, avec des activités professionnelles. Mais à l’opposé, également, par exemple, dans le cadre de la mandarine de printemps : une innovation technologique née dans nos labos, que l’on transfère, que l’on va mettre en production, au service des agrumiculteurs, de cette filière puissante qui apporte de la richesse en Corse et sert donc à son développement.
André Torre vient de recevoir une nouvelle reconnaissance de la communauté internationale de la recherche : il a été nommé top scientiste. Pour l’ensemble de sa carrière, et en rapport avec le nombre de citations de ses travaux dans des revues scientifiques, il est classé 29ème mondial dans le domaine du rural et 4ème dans celui de l’économie rurale.
-
Grève des brancardiers STC : « Non, l’Hôpital d’Ajaccio ne se désagrège pas, les patients sont correctement pris en charge » répond la CFDT
-
Crise des transports maritimes : première réunion à Bastia après la fin de la grève
-
77 médailles pour les vins et les produits corses au concours général agricole
-
Luri : une enquête ouverte après l’incendie d’un engin de chantier
-
Municipales. Pascal Zagnoli dévoile sa liste "Stintu Aiaccinu"








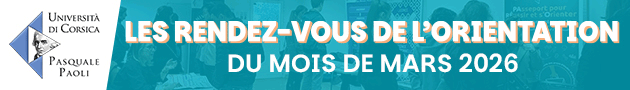




 Envoyer à un ami
Envoyer à un ami Version imprimable
Version imprimable





