«L’exposition présente des pièces issues de travaux récents et une pièce créée spécifiquement pour l’événement, autour de la plage de Nonza » souligne Juana Macari, la directrice du centre culturel.
Pour cette exposition, le couple présente pour la première fois en ensemble d’œuvres personnelles et en duo. Leurs travaux se rencontrent sur le geste et l’outil, la ligne et l’ossature, la géographie et l’in-situ, la trame et le motif, les notions de limite et de seuil, le paysage et sa représentation.
Associant des formes façonnées et déduites, des mécaniques industrielles et des gestes artisanaux, des rapports entre règles et hasard, de rythme, d’occurences de textures et de couleurs, ils construisent pour Una Volta un phrasé par paliers, par micro-ensembles, attentifs aux ambiances et aux polysémies de sens qu’elles produisent.
Sur trois étages on peut y admirer le travail de Linda Sanchez qui joue avec les lois et les phénomènes physiques : propriétés, combinaison, changement d’état. La jeune et talentueuse artiste produit des gestes de capture, de relevé, de prélèvement et développe des outils et des dispositifs d’observation. Le mouvement, autant transcrit que réactivé, trame une grande partie de ses travaux. Sur la question de la surface et du plan, elle explore de nouvelles occurrences et méthodes de travail, jouant aussi sur des codes culturels et éthiques : réponses in situ, mise en scène et représentations.
Baptiste Croze développe lui un travail aux formes éclectiques, constitué de gestes simples, de détournements d’objets et de situations à l’encontre des diverses conventions de représentation, de genre et de style. Il réalise des gestes éphémères, temporaires et réactivables impulsés par des systèmes et protocoles. Ceux-ci déterminent des règles et des cadres empiriques qui intègrent leurs propres changements, produisent des collectes d’objets, de matériaux et/ou d’images transformés ou détournés. L’artiste s’intéresse aux origines, aux moyens de fabrication et de reproduction des objets suivant des techniques modernes et traditionnelles.
Le récit de l’exposition se découpe par paliers, par ensembles, suivant les étages de l’espace d’Una Volta et de ses différentes ambiances, caractéristiques architecturales , profondeur, luminosité, nature de sols.
Dans la première salle, on entre d’abord dans une salle carrelée blanche, un sorte de sas dans laquelle « coup sur coup » mêle rigueur géométrique, répétition tactile et pur hasard, un paradoxe entre accidents fissurés et forme mathématique. Puis en s’avançant sur le sol foncé des pierres de lauze laissées brutes en surface, une ambiance pétrole assemble plusieurs œuvres. « Le maquis » est une toile de tente au motif camouflage dont seule reste l’ossature dénudée et ramollie. Le sol est jonché du motif coloré vert, noir et argent, qui a été méticuleusement découpé, motif par motif et soustrait de sa structure, retombants par terre, comme le feuillage dispersé d’un humus. Faux semblant et apparences de textures et de matière, le motif camouflage trouve son origine dans le regard du peintre sur le paysage, sa représentation et sa possible abstraction. « L’or gris », accroché au mur, sur son étalon, est un sac poubelle noir et vert qui a été patiemment étiré, détendu dans son entier. Transfigurant la matière plastique en une sorte de coquillage, de forme apparemment naturelle et organique.
En montant et entre chaque étage, les artistes annotent d’autres liaisons, comme les « drawing fingers », « coup sur coup » ou « formes données », associant dans le parcours de l’expo, des incises, des rebonds et des alinéas.
Au premier étage, le sol dénudé sur un opus incertum crème et orangé, tient comme socle pour une nouvelle épreuve des « sourdines ». Les fenêtres habituellement obstruées pour l’espace de projection sont ré-ouvertes et laissent entrer à nouveau la lumière naturelle. « Les Sourdines » sont un ensemble indépendant d’objets et de matériaux dont les creux sont remplis à l’enduit de lissage, puis poncés. Cette double opération de masquage/déshabillage révèle leurs crêtes, lignes et creux pour modéliser leurs volumes réels. Linda et Baptiste ont resserrés le corpus des sourdines à des carottages et des meules en pierres corses. De diamètres et de hauteurs diverses, de couleurs, de textures, matériaux et marques d’usures variés, c’est un ensemble pluriel et homogène en même temps. Posés sur la tranche ou à plat, sur le flanc ou la tête, c’est la même figure géométrique dans toutes ses variances rondes et circulaires, cylindriques, de la rondelle au tube. La trajectoire entre elles opère aussi un glissement de fonction, entre le diagnostique terrestre qu’est le carottage et l’outil servant à affuter ou à moudre qu’est la meule. Une fois encore, l’installation livre une double lecture entre l’usage et le traitement, entre la mécanique du geste et la nature du matériau d’origine, entre la part façonnée et déduite, produite et fortuite.
Procédant de la même manière simultanément en série et en unicités, les « zip », « 6 secondes », « 15 secondes » et « 27 secondes » sont à chaque fois deux scies d’un même modèle posées l’une sur l’autre sur la partie dentée. L’écart entre les dates et horaires de fabrication, marquée par la chaîne industrielle, correspond à l’intervalle minimum (suivi) entre deux éléments du modèle en question.
Dans la continuité des « formes données », les zip sont la correspondance fatale et logique entre deux instant T d’une vitesse insaisissable (celle de l’industrie), et physiquement refermées sur elles-mêmes, comme un secret. Leur accrochage horizontal s’aligne avec le niveau raz d’une coulée ou d’un horizon, résonance implicite avec le geste vectoriel des sourdines.
« 11752 mètres et des poussières… » est une film de 71 minutes suivant obstinément une goutte d’eau. L’origine, la vie, la fin d’une goutte. Filmée en macro, elle glisse longuement sur une surface dont on ne distingue ni les bords, ni la pente ni la nature. Le point de vue est à son angle mort. L’infinie glissade de la goutte est réalisée grâce à un outil qui lui fait faire du surplace. C’est la surface qui remonte à contresens de sa descente. Le filmage en course poursuite s’apparente aux techniques de documentaire animalier sauvage. Le film a été réalisé sur le toit du château d’eau de Décines-Charpieu. La bande son est l’environnement direct et sans retouche du tournage : vent, cloches d’églises, chien qui aboie…
Enfin au deuxième et dernier étage, les artistes ont choisi d’enlever le systeme d’éclairage et de laisser cette salle en voute baignée dans sa lumière naturelle. Accentuant l’ ambiance atypique de cet espace, perché, intemporel, rêveur, entre plusieurs lieux, Sanchez&Croze associent plusieurs états , formes et gestes à partir du vocabulaire premier originel de leur pratique. C’est un carnet de notes de formes composites, d’objets trouvés, élimés, de gestes réactivés, de protocoles et de formules, d’attentions distraites, de tests. On pourrait avoir un doute sur le fait que cela précède ou succède l’exposition. L’ensemble décrit des micro-affiliations, des rebonds visuels et des échos plastiques, de la singularité d’une texture à la mécanique d’une opération, de l’ occurence d’une couleur à la précision d’une répétition. Elle mesure les minces écarts entre des plasticités, des modes d’apparition, des associations physiques, des règles de tenue, des verticalités et horizontalités…L’installation peut se lire comme un atelier, cet endroit singulier, autant physique que mental, où les formes tiennent en suspension entre leur potentiel devenir et leur reste tangible.A mi chemin entre les « Sculptural Studies » et « l’autre » , c’est un espace d’étude, une page remplie d’annotations, de figures, de ponctuations qui décrivent avec précision leur « faire », leur monde.
Le décor est planté, il ne vous reste plus qu’à aller admirer cette belle et originale expo.
Pour cette exposition, le couple présente pour la première fois en ensemble d’œuvres personnelles et en duo. Leurs travaux se rencontrent sur le geste et l’outil, la ligne et l’ossature, la géographie et l’in-situ, la trame et le motif, les notions de limite et de seuil, le paysage et sa représentation.
Associant des formes façonnées et déduites, des mécaniques industrielles et des gestes artisanaux, des rapports entre règles et hasard, de rythme, d’occurences de textures et de couleurs, ils construisent pour Una Volta un phrasé par paliers, par micro-ensembles, attentifs aux ambiances et aux polysémies de sens qu’elles produisent.
Sur trois étages on peut y admirer le travail de Linda Sanchez qui joue avec les lois et les phénomènes physiques : propriétés, combinaison, changement d’état. La jeune et talentueuse artiste produit des gestes de capture, de relevé, de prélèvement et développe des outils et des dispositifs d’observation. Le mouvement, autant transcrit que réactivé, trame une grande partie de ses travaux. Sur la question de la surface et du plan, elle explore de nouvelles occurrences et méthodes de travail, jouant aussi sur des codes culturels et éthiques : réponses in situ, mise en scène et représentations.
Baptiste Croze développe lui un travail aux formes éclectiques, constitué de gestes simples, de détournements d’objets et de situations à l’encontre des diverses conventions de représentation, de genre et de style. Il réalise des gestes éphémères, temporaires et réactivables impulsés par des systèmes et protocoles. Ceux-ci déterminent des règles et des cadres empiriques qui intègrent leurs propres changements, produisent des collectes d’objets, de matériaux et/ou d’images transformés ou détournés. L’artiste s’intéresse aux origines, aux moyens de fabrication et de reproduction des objets suivant des techniques modernes et traditionnelles.
Le récit de l’exposition se découpe par paliers, par ensembles, suivant les étages de l’espace d’Una Volta et de ses différentes ambiances, caractéristiques architecturales , profondeur, luminosité, nature de sols.
Dans la première salle, on entre d’abord dans une salle carrelée blanche, un sorte de sas dans laquelle « coup sur coup » mêle rigueur géométrique, répétition tactile et pur hasard, un paradoxe entre accidents fissurés et forme mathématique. Puis en s’avançant sur le sol foncé des pierres de lauze laissées brutes en surface, une ambiance pétrole assemble plusieurs œuvres. « Le maquis » est une toile de tente au motif camouflage dont seule reste l’ossature dénudée et ramollie. Le sol est jonché du motif coloré vert, noir et argent, qui a été méticuleusement découpé, motif par motif et soustrait de sa structure, retombants par terre, comme le feuillage dispersé d’un humus. Faux semblant et apparences de textures et de matière, le motif camouflage trouve son origine dans le regard du peintre sur le paysage, sa représentation et sa possible abstraction. « L’or gris », accroché au mur, sur son étalon, est un sac poubelle noir et vert qui a été patiemment étiré, détendu dans son entier. Transfigurant la matière plastique en une sorte de coquillage, de forme apparemment naturelle et organique.
En montant et entre chaque étage, les artistes annotent d’autres liaisons, comme les « drawing fingers », « coup sur coup » ou « formes données », associant dans le parcours de l’expo, des incises, des rebonds et des alinéas.
Au premier étage, le sol dénudé sur un opus incertum crème et orangé, tient comme socle pour une nouvelle épreuve des « sourdines ». Les fenêtres habituellement obstruées pour l’espace de projection sont ré-ouvertes et laissent entrer à nouveau la lumière naturelle. « Les Sourdines » sont un ensemble indépendant d’objets et de matériaux dont les creux sont remplis à l’enduit de lissage, puis poncés. Cette double opération de masquage/déshabillage révèle leurs crêtes, lignes et creux pour modéliser leurs volumes réels. Linda et Baptiste ont resserrés le corpus des sourdines à des carottages et des meules en pierres corses. De diamètres et de hauteurs diverses, de couleurs, de textures, matériaux et marques d’usures variés, c’est un ensemble pluriel et homogène en même temps. Posés sur la tranche ou à plat, sur le flanc ou la tête, c’est la même figure géométrique dans toutes ses variances rondes et circulaires, cylindriques, de la rondelle au tube. La trajectoire entre elles opère aussi un glissement de fonction, entre le diagnostique terrestre qu’est le carottage et l’outil servant à affuter ou à moudre qu’est la meule. Une fois encore, l’installation livre une double lecture entre l’usage et le traitement, entre la mécanique du geste et la nature du matériau d’origine, entre la part façonnée et déduite, produite et fortuite.
Procédant de la même manière simultanément en série et en unicités, les « zip », « 6 secondes », « 15 secondes » et « 27 secondes » sont à chaque fois deux scies d’un même modèle posées l’une sur l’autre sur la partie dentée. L’écart entre les dates et horaires de fabrication, marquée par la chaîne industrielle, correspond à l’intervalle minimum (suivi) entre deux éléments du modèle en question.
Dans la continuité des « formes données », les zip sont la correspondance fatale et logique entre deux instant T d’une vitesse insaisissable (celle de l’industrie), et physiquement refermées sur elles-mêmes, comme un secret. Leur accrochage horizontal s’aligne avec le niveau raz d’une coulée ou d’un horizon, résonance implicite avec le geste vectoriel des sourdines.
« 11752 mètres et des poussières… » est une film de 71 minutes suivant obstinément une goutte d’eau. L’origine, la vie, la fin d’une goutte. Filmée en macro, elle glisse longuement sur une surface dont on ne distingue ni les bords, ni la pente ni la nature. Le point de vue est à son angle mort. L’infinie glissade de la goutte est réalisée grâce à un outil qui lui fait faire du surplace. C’est la surface qui remonte à contresens de sa descente. Le filmage en course poursuite s’apparente aux techniques de documentaire animalier sauvage. Le film a été réalisé sur le toit du château d’eau de Décines-Charpieu. La bande son est l’environnement direct et sans retouche du tournage : vent, cloches d’églises, chien qui aboie…
Enfin au deuxième et dernier étage, les artistes ont choisi d’enlever le systeme d’éclairage et de laisser cette salle en voute baignée dans sa lumière naturelle. Accentuant l’ ambiance atypique de cet espace, perché, intemporel, rêveur, entre plusieurs lieux, Sanchez&Croze associent plusieurs états , formes et gestes à partir du vocabulaire premier originel de leur pratique. C’est un carnet de notes de formes composites, d’objets trouvés, élimés, de gestes réactivés, de protocoles et de formules, d’attentions distraites, de tests. On pourrait avoir un doute sur le fait que cela précède ou succède l’exposition. L’ensemble décrit des micro-affiliations, des rebonds visuels et des échos plastiques, de la singularité d’une texture à la mécanique d’une opération, de l’ occurence d’une couleur à la précision d’une répétition. Elle mesure les minces écarts entre des plasticités, des modes d’apparition, des associations physiques, des règles de tenue, des verticalités et horizontalités…L’installation peut se lire comme un atelier, cet endroit singulier, autant physique que mental, où les formes tiennent en suspension entre leur potentiel devenir et leur reste tangible.A mi chemin entre les « Sculptural Studies » et « l’autre » , c’est un espace d’étude, une page remplie d’annotations, de figures, de ponctuations qui décrivent avec précision leur « faire », leur monde.
Le décor est planté, il ne vous reste plus qu’à aller admirer cette belle et originale expo.












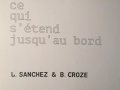






















 Envoyer à un ami
Envoyer à un ami Version imprimable
Version imprimable





