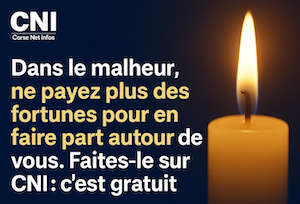(Antoine Lozano)
Selon les dernières données du service européen Copernicus, la température moyenne de surface sur l’ensemble du bassin méditerranéen s’élève actuellement à 25,1 °C, un record absolu pour un mois de juin. Ce niveau dépasse de 2,7 °C les normales observées sur la période 1991–2020. En cause, un puissant anticyclone d’origine africaine qui, en s’installant durablement sur la région, fait remonter des masses d’air chaud vers le nord. Ce phénomène, combiné à un ensoleillement intense et une mer particulièrement calme, entraîne une accumulation rapide de chaleur dans les eaux superficielles.
☀️ A marine heatwave is ongoing in the Mediterranean Sea.
This data visualisation, based on @CMEMS_EU data, shows sea surface temperature anomalies recorded on 22 June.
Areas in dark🔴 indicate temperatures more than 5°C above the seasonal average.#ImageOfTheDay #CopernicusEU pic.twitter.com/18hYbl6Tmn
— Copernicus EU (@CopernicusEU) June 25, 2025
Les conséquences de cette surchauffe ne se limitent pas à des chiffres abstraits. Dans les zones littorales, la chaleur de la mer devient un véritable enjeu de santé publique. Elle favorise la prolifération de certaines bactéries comme les Vibrio, présentes naturellement dans les eaux chaudes, mais potentiellement dangereuses pour les baigneurs, notamment en cas de plaies ouvertes. Cette situation peut également aggraver l’impact des « nuits tropicales », ces nuits où les températures ne descendent pas en dessous des 20 °C, et qui perturbent le sommeil, fragilisent les organismes et augmentent les risques cardio-respiratoires, surtout chez les personnes vulnérables.
Sur le plan environnemental, les signaux sont tout aussi préoccupants. L’écosystème marin peine à s’adapter à une montée aussi brutale des températures. Des algues filamenteuses prolifèrent anormalement, recouvrant les fonds marins, étouffant coraux et herbiers, et perturbant la photosynthèse. Plusieurs espèces sont en souffrance, notamment les coquillages comme les moules ou les huîtres, particulièrement sensibles aux pics de chaleur. À terme, si cette tendance se confirme, certaines simulations indiquent que ces organismes pourraient ne plus survivre dès le mois de juin d’ici 2050.
Cette mutation rapide du milieu marin entraîne déjà des effets visibles sur les activités humaines. La pêche, par exemple, doit s’adapter : les poissons désertent les eaux superficielles trop chaudes et se réfugient en profondeur, rendant leur capture plus difficile. Plus globalement, la surchauffe de la mer pourrait accentuer le déséquilibre climatique, en réduisant la capacité des océans à absorber le carbone, affaiblissant ainsi un des principaux régulateurs naturels du climat mondial.
Sur le plan environnemental, les signaux sont tout aussi préoccupants. L’écosystème marin peine à s’adapter à une montée aussi brutale des températures. Des algues filamenteuses prolifèrent anormalement, recouvrant les fonds marins, étouffant coraux et herbiers, et perturbant la photosynthèse. Plusieurs espèces sont en souffrance, notamment les coquillages comme les moules ou les huîtres, particulièrement sensibles aux pics de chaleur. À terme, si cette tendance se confirme, certaines simulations indiquent que ces organismes pourraient ne plus survivre dès le mois de juin d’ici 2050.
Cette mutation rapide du milieu marin entraîne déjà des effets visibles sur les activités humaines. La pêche, par exemple, doit s’adapter : les poissons désertent les eaux superficielles trop chaudes et se réfugient en profondeur, rendant leur capture plus difficile. Plus globalement, la surchauffe de la mer pourrait accentuer le déséquilibre climatique, en réduisant la capacité des océans à absorber le carbone, affaiblissant ainsi un des principaux régulateurs naturels du climat mondial.
Cet épisode extrême est un marqueur de plus du dérèglement climatique en cours. Il pose un défi immédiat aux scientifiques, aux pouvoirs publics et aux acteurs de la mer, qui devront conjuguer surveillance accrue, adaptation des pratiques et prévention des risques. Car si cette situation devient la norme dans les prochaines décennies, les conséquences pourraient être lourdes, aussi bien pour les écosystèmes que pour les populations littorales sans oublier que des températures de surface de la mer plus élevées entraînent des tempêtes et des conditions météorologiques plus violentes.
Alexandre Vela et Romain Bastien (Stella Mare) : "être attentifs, sans tirer de conclusions hâtives"
Alexandre Vela et Romain Bastien, ingénieurs à la plateforme Stella Mare à Biguglia, ne travaillent pas directement sur les effets du réchauffement des eaux méditerranéennes. Pourtant, ces deux fins connaisseurs du milieu marin en observent avec attention les évolutions.
Alexandre Vela est ingénieur et responsable des programmes « milieux et sensibilisation » de la plateforme de recherche. Il joue un rôle clé dans la gestion et le développement de projets de reproduction et de restauration écologique d’espèces marines en déclin, comme l’huître plate ou l’oursin violet. Romain Bastien, responsable « ingénierie et moyens », est quant à lui habilité par le CNRS à diriger des plongées scientifiques.
Tous deux reconnaissent qu’il est encore difficile de mesurer précisément les effets à long terme du réchauffement sur le monde sous-marin. « On a déjà pu constater en 2024 des pics de 31 °C à 8 mètres de profondeur, ce qui est pour le moins surprenant ! » notent-ils.
«Pour autant, il est encore trop tôt pour affirmer que cette montée en température aura un impact négatif et délétère sur l’ensemble des espèces. »
Le réchauffement accélère cependant certains phénomènes bien visibles, comme le développement des espèces invasives – à l’image du crabe bleu – ou la surmortalité constatée chez les huîtres en 2023. Si les plans d’eau fermés en Corse ont montré des signes clairs de réchauffement, les ingénieurs insistent sur la nécessité de rester prudents dans l’analyse : « Toutes les espèces ne réagissent pas de la même manière au même moment. Leurs cycles biologiques pourraient en être affectés, par exemples avec des périodes de ponte plus précoces ou des croissances plus rapides. »
Face à ces signaux, parfois discrets, Alexandre Vela et Romain Bastien appellent à rester humbles. « Ce sont des équilibres complexes. Il faut être attentif, sans tirer de conclusions hâtives. »
Alexandre Vela est ingénieur et responsable des programmes « milieux et sensibilisation » de la plateforme de recherche. Il joue un rôle clé dans la gestion et le développement de projets de reproduction et de restauration écologique d’espèces marines en déclin, comme l’huître plate ou l’oursin violet. Romain Bastien, responsable « ingénierie et moyens », est quant à lui habilité par le CNRS à diriger des plongées scientifiques.
Tous deux reconnaissent qu’il est encore difficile de mesurer précisément les effets à long terme du réchauffement sur le monde sous-marin. « On a déjà pu constater en 2024 des pics de 31 °C à 8 mètres de profondeur, ce qui est pour le moins surprenant ! » notent-ils.
«Pour autant, il est encore trop tôt pour affirmer que cette montée en température aura un impact négatif et délétère sur l’ensemble des espèces. »
Le réchauffement accélère cependant certains phénomènes bien visibles, comme le développement des espèces invasives – à l’image du crabe bleu – ou la surmortalité constatée chez les huîtres en 2023. Si les plans d’eau fermés en Corse ont montré des signes clairs de réchauffement, les ingénieurs insistent sur la nécessité de rester prudents dans l’analyse : « Toutes les espèces ne réagissent pas de la même manière au même moment. Leurs cycles biologiques pourraient en être affectés, par exemples avec des périodes de ponte plus précoces ou des croissances plus rapides. »
Face à ces signaux, parfois discrets, Alexandre Vela et Romain Bastien appellent à rester humbles. « Ce sont des équilibres complexes. Il faut être attentif, sans tirer de conclusions hâtives. »
Alors même que la communauté scientifique s’effraie des records des deux dernières années, la température de surface de la mer Méditerranée atteint des niveaux exceptionnellement élevés, jamais observés à une fin juin.
En perdant son rôle de régulateur thermique, la mer ne… pic.twitter.com/uzNNuzHP4h
— Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) June 23, 2025
-
L'Assemblée de Corse rend un dernier hommage à Dominique Bucchini
-
Incendies de bateaux à Saint-Florent : quatre jeunes hommes présentés à un juge d'instruction
-
Municipales. Vannina Luzi-Chiarelli mènera la liste soutenue par Femu a Corsica et Core in Fronte à Porto-Vecchio
-
Reconstitution judiciaire au Lamparo à Ajaccio : circulation et stationnement interdits, écoles fermées ce vendredi 30 janvier
-
La RD 18 fermée à Castirla en raison d'un éboulement



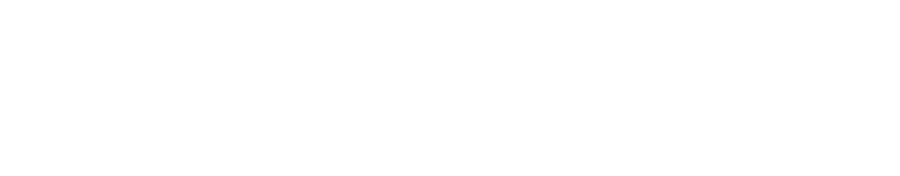






 Envoyer à un ami
Envoyer à un ami Version imprimable
Version imprimable